Lieu d’ombre et de silence, la cave persiste dans nos imaginaires comme espace d’effroi, de refoulement et de transgressions. Elle condense nos peurs, nos fantasmes et nos restes encombrants, même quand l’architecture contemporaine l’a effacée.
La cave n’est pas seulement un espace technique où s’entassent bouteilles, vieilles poussettes et toiles d’araignées. Elle est une topographie sociale : zone basse, cryptique, où se concentrent nuisibles, clandestins et pratiques honteuses. Marchands de sommeil, trafics, violences collectives, tout cela prospère (aussi) dans cet étage inférieur, comme si le béton lui-même attirait l’ombre. « Descendre à la cave » n’est jamais neutre : on y va à reculons, on s’y engage comme dans un rituel initiatique, avec la peur d’y croiser ce que l’on préfère tenir à distance.
Proxémie de l’enfoui
Avec Abraham Moles, on comprend que la cave est d’abord une affaire de distance. Elle est reléguée au bas de l’immeuble, au plus loin du quotidien socialisé. C’est un espace repoussoir, ghetto spatial de tout ce qui ne doit pas être vu, ni même pensé. La cave est ce que l’on met en bas pour se hisser vers le haut. Le rez-de-chaussée se veut transparent, vitré, accueillant ; la cave s’enfonce dans l’opacité, l’oubli et les poubelles à une portée de narines. Elle est la part cryptée de l’architecture, l’archive sombre de la maison.
Psychanalyse du bas-fond
La cave, c’est le refoulé. Freud aurait pu en faire un schéma topographique : le moi se pavane à l’étage, le surmoi s’élève dans les hauteurs, mais l’inconscient s’entasse au sous-sol. La cave est la matérialisation architecturale de ce refoulé, un espace de honte et de pulsions où s’exercent les fantasmes les plus inavouables. On y cache l’alcool, les photos interdites, les armes de famille, les papiers compromettants. Elle est un ventre noir, une mémoire étouffée, où chacun descend parfois à contrecœur, découvrant ses propres restes intimes.
Baudrillard rappelle que les objets fonctionnent en système, non par leur usage mais par la fiction qu’ils produisent. La cave participe de ce système des lieux : même vide, elle reste remplie d’images. Elle évoque immédiatement l’effroi, la clandestinité, l’illégalité.
Cave intérieure, cave imaginaire et simulacre du sous-sol
Dans les constructions modernes, elle a disparu, remplacée par des parkings aseptisés ou des box sécurisés. Mais cette disparition physique ne fait que renforcer son existence et sa topographie symboliques. Le simulacre de la cave survit, flottant dans l’imaginaire collectif comme un reste nécessaire. Car la cave existe en chacun de nous, qu’on le veuille ou non. C’est ce recoin psychique où l’on relègue les pensées indésirables, les désirs honteux, les souvenirs qui collent. Elle est ce que nous ne voulons pas regarder en face, mais qui revient parfois, par effraction, dans les cauchemars. La cave intérieure, c’est l’autre nom de l’angoisse, ce lieu sans fenêtres où la raison refuse d’éclairer.
J’ose dire que « l’enfer, c’est la cave ». Ce n’est pas seulement une parodie mais une vérité symbolique : la cave, est l’espace de l’ombre qui rend possible la lumière des étages supérieurs. Si elle a disparu des plans d’architecte, elle n’a pas quitté les imaginaires. Nous portons tous une cave en nous, et c’est sans doute elle qui nous retient d’être totalement transparents, totalement exposés, totalement vidés. Le mystère persiste, et c’est peut-être ce qui nous sauve.
(c) Ill. têtière : Pr4vd4.net

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.









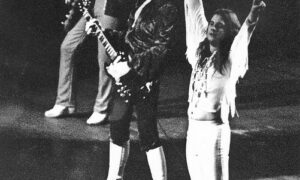





























Commentez cet article de Pr4vd4