Un parfum sucré flotte sur les murs, dès les premières salles du Petit Palais. On y croise des joues rondes, des lèvres ourlées, des regards levés vers quelque ciel domestique. Les enfants de Greuze sont là, innombrables, dociles et rêveurs, allégories d’un âge de pureté que le XVIIIᵉ siècle bourgeois se plaisait à idéaliser. Le titre de l’exposition, L’enfance en lumière, semble promettre la redécouverte d’un peintre des Lumières ; il offre plutôt la contemplation d’un siècle en pleine contradiction, où la morale et le sentiment se conjuguent pour produire l’une des plus belles mièvreries picturales de la modernité naissante.
Portraits d’enfants et superficialité
L’accrochage, feutré comme un boudoir de Fragonard, reconstitue l’atmosphère d’un intérieur du XVIIIᵉ siècle : moulures, papiers peints, tons crème et vert amande signés Farrow & Ball. On entre dans le salon d’un peintre des bonnes mœurs, où les petits paresseux, petits écoliers et petites Nanette posent avec la componction d’angelots de porcelaine. Le Petit paresseux (1755, musée Fabre), tout endormi sur son livre, ou Le petit écolier (v. 1757, National Galleries of Scotland) appartiennent à cette veine édifiante que Diderot, dans un élan de tendresse morale, célébrait comme l’expression de « l’âme sensible ». On y perçoit déjà cette tension : un peintre que l’on voudrait des Lumières, mais dont l’éclairage demeure celui d’une chandelle domestique.
La scénographie divise le parcours en sections suggestives : Aimer, allaiter, éduquer ; Histoires de famille ; Théâtres intimes. Les titres, à eux seuls, sonnent comme le catéchisme d’une morale sociale : l’enfant aimé, allaité, corrigé, façonné. Derrière les apparences de la tendresse, c’est une conception paternaliste du lien familial qui s’expose, héritée autant de Rousseau que du catéchisme de Port-Royal. Greuze peint moins l’enfance qu’il ne peint l’idée que les adultes se font de l’enfance. Ses nourrices, mères et pères ne sont que les figurants d’une pastorale morale où la société d’Ancien Régime règle, pinceau en main (si l’on peut dire), la question du devoir domestique.
À ce théâtre policé répondent les drames familiaux que Greuze affectionne. Le Gâteau des rois (1774, musée Fabre) ou La Lecture de la Bible (Louvre) font de la cellule bourgeoise une scène d’édification. La morale s’y distribue à parts égales entre le père autoritaire, la mère vertueuse et l’enfant ému. Et pourtant, à force de vertu, tout s’y fige : les gestes sont convenus, la tendresse apprêtée, le désordre interdit. D’où la sensation persistante que cette enfance « en lumière » est en réalité prisonnière de son propre clair-obscur moral.
La Cruche cassée, toile profonde (et exception)
Une exception, pourtant, fissure ces représentations : La Cruche cassée (1771-1772, musée du Louvre). Dans cette toile, Greuze quitte le théâtre des bons sentiments pour atteindre une vérité autrement plus troublante. La jeune fille, à la robe froissée, à la main crispée sur son ventre, incarne une innocence perdue ; la cruche brisée, symbole éloquent (et assorti d’autres signes, comme la forme phallique de la fontaine), dit ce que le siècle tait : la violence faite au corps féminin, la honte, le silence. En vis-à-vis, L’Oiseleur accordant sa guitare (1757, Varsovie, National Museum) et Les Œufs cassés (1756, Metropolitan Museum of Art) prolongent cette symbolique érotique, où la séduction tourne à la faute (en cachant la prédation). Ici, le drame perce sous le vernis, et Greuze, peut-être malgré lui, rejoint la gravité d’un Rembrandt, dans Suzanne et les vieillards. Mais chez lui, nul élan clivant, nulle « disruption » comme on dirait aujourd’hui, ni dans le sujet, ni dans l’angle choisi. Greuze n’est ni Boucher, ni Fragonard, ni Baudouin.
Le reste du parcours, en revanche, ressasse la tendresse obligatoire. Les têtes d’enfants à la sanguine (Tête de jeune fille, v. 1773) rivalisent de roseurs pédagogiques (le fameux « roseur à rosé ») ; les mères allaitantes (L’Heureuse mère, v. 1766) déclinent une iconographie de la vertu nourricière digne des traités d’hygiène morale. Sous couvert de célébrer les idéaux de Rousseau et de Diderot, l’exposition reconduit une vision genrée et domestiquée de l’éducation : celle du foyer comme rempart, de la mère comme sanctuaire, de l’enfance comme capital moral. Que les commissaires aient intitulé certaines salles Aimer, allaiter, éduquer n’est pas anodin : on y entend moins l’écho des Lumières que les accents, plus tardifs, d’un hygiénisme bourgeois et d’un familialisme que Vichy n’aurait pas reniés.
Certes, La Malédiction paternelle (1777) et Le Fils puni (1778), pendants célèbres du Louvre, ajoutent à la palette une touche de pathétique tragique : le père qui maudit, le fils qui s’enfuit, puis revient repentant. Mais ces grands drames moraux sentent déjà la scène de théâtre plus que la chair de vie. L’émotion y est réglée, chorégraphiée, comme pour rassurer le spectateur sur la permanence d’un ordre moral : tout dérapage y appelle la punition, toute faute, la rédemption. Derrière la sensibilité, c’est encore la discipline qui parle. Foucault, au secours !
Et pourtant, on devine chez Greuze une tension plus complexe : celle d’un artiste pris entre la dévotion familiale et le désir d’émancipation. L’épisode du Septime Sévère reprochant à son fils Caracalla d’avoir voulu l’assassiner (1767-1769, Louvre), morceau de réception refusé par l’Académie, témoigne d’un autre Greuze : un peintre tenté par la peinture d’histoire, la morale républicaine, le drame antique. On voudrait que l’exposition insiste davantage sur cette veine, prémices du néoclassicisme de David. Au lieu de cela, elle préfère le confort des sentiments convenus à la lucidité politique des Lumières.
Ainsi se referme ce « théâtre de l’intime » : aimable, instructif, mais profondément ambivalent. Sous le vernis attendri des visages enfantins, on peine à discerner la pensée vive des encyclopédistes. Ce que l’exposition nomme « enfance » n’est peut-être qu’une invention d’adulte ; ce qu’elle nomme « lumière », un reflet domestique d’un siècle qui croyait éclairer le monde en peignant des angelots bien peignés. Attendons la génération suivante, celle de David et de la Révolution, pour que la peinture, enfin, cesse de bercer l’innocence et affronte la vérité.
***
(c) ill. têtière Jean-Baptiste Greuze, La Cruche cassée, 1771, Musée du Louvre

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.














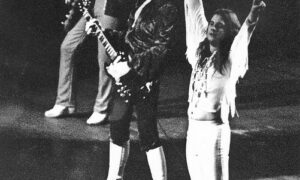





























Commentez cet article de Pr4vd4