Au cinquième étage du musée d’Orsay, dans les galeries baignées par la clarté grise de la Seine, une vibration étrange saisit le regard. Ce n’est ni tout à fait la lumière des impressionnistes, ni l’abstraction chromatique d’une artiste contemporaine : c’est l’entre-deux où se tient Bridget Riley. Point de départ, une exposition qui met en scène la filiation intime entre la Britannique Bridget Riley (née en 1931) et Georges Seurat, son maître invisible, son point d’origine et son miroir lointain.
Conçue comme un dialogue à travers le temps, l’exposition revient sur ce moment fondateur de 1959 où Riley, alors jeune artiste en quête d’un langage, copie Le Pont de Courbevoie d’après une simple reproduction imprimée. De ce geste d’appropriation naîtra toute une vie de peinture. Riley y découvre que la juxtaposition des couleurs peut générer un mouvement interne, que la perception elle-même est matière picturale. À partir de là, elle ne peindra plus la lumière : elle la fera agir.
Rencontre avec Seurat
Riley se souvient de sa première rencontre avec Seurat à la National Gallery en 1949, face à Une baignade à Asnières. Non pas le sujet, ni le contexte social, mais la « pensée picturale » la captive — cette manière de donner à la peinture une rigueur scientifique, presque architectonique. Elle en retient moins la scène que le principe : la couleur comme structure. Son Pont de Courbevoie (copie, 1959), présenté ici comme un talisman de travail, atteste d’une démarche analytique : comprendre Seurat par la main, et non par le discours.
Cette reproduction, que l’artiste conserve toujours dans son atelier de Londres, devient ici le pivot d’un parcours qui se déploie des salles Van Gogh aux galeries postimpressionnistes. La scénographie souligne les correspondances : d’un côté, Seurat et les pionniers du divisionnisme ; de l’autre, Riley et ses toiles vibrantes où la géométrie devient lumière.
De la division à la vibration
En juxtaposant les toiles de Seurat et les grandes compositions optiques de Riley, l’exposition révèle une continuité presque secrète : celle d’une recherche sur la perception, la rétine et le rythme. Le point, chez Seurat, devient chez Riley ligne, onde, champ. Là où le maître du XIXᵉ siècle combinait des touches pour recomposer la lumière, Riley agence des bandes chromatiques, des grilles et des dégradés qui semblent en mouvement. Dans Chant 2 (1967) ou Ra 2 (1981), les surfaces oscillent, s’animent, semblent respirer — non par illusion, mais par activation du regard.
La leçon de Seurat s’y rejoue à l’échelle du XXᵉ siècle : la couleur n’est plus seulement descriptive, elle est opératoire. Comme l’écrit Riley : « Copier Seurat m’a permis de comprendre la pensée picturale. J’ai observé son travail, je l’ai analysé à travers ma copie, puis je l’ai adapté à mes moyens. » De là naît l’idée que la peinture n’a pas à représenter la lumière : elle est lumière.
Une relecture de l’histoire de l’art
Le mérite de l’exposition, dirigée par Sylvain Amic et Nicolas Gausserand, est précisément de ne pas enfermer Riley dans l’étiquette commode de l’Op Art. En la plaçant au cœur même du musée d’Orsay — ce temple du postimpressionnisme —, elle apparaît non comme une rupture, mais comme une héritière. L’œil du visiteur, habitué aux dégradés feutrés de Signac ou de Cross, retrouve dans les bandes de Riley une tension similaire : un art de la vibration, une science du contraste.
Les commissaires inscrivent cette filiation dans un espace symbolique : les toiles de Riley, suspendues à proximité des chefs-d’œuvre de Seurat, dialoguent avec la Seine visible à travers les baies vitrées, motif commun aux deux artistes. Le paysage fluvial devient ainsi une métaphore : celle du flux visuel, du passage entre deux époques, entre figuration et abstraction.
Un hommage réciproque
Riley parle souvent de Seurat comme d’un « compagnon de route ». Ses œuvres tardives, telles Intervals 5 (2019) ou Bagatelle 1 (2015), en offrent une résonance apaisée : la rigueur du système s’y conjugue à une sensualité colorée que Seurat lui-même aurait pu revendiquer. Les bleus y s’entrechoquent avec des verts acides, les blancs s’ouvrent sur des gris lumineux, comme si la vibration initiale du Pont de Courbevoie s’était déployée dans un espace infini.
L’exposition insiste sur cette continuité, sans céder au didactisme. Des croquis préparatoires, des études de tons, des maquettes de Riley permettent de comprendre comment la couleur, chez elle, est toujours pensée comme relation. On y retrouve la même discipline méthodique que chez Seurat, mais transposée dans une écriture d’une pureté radicale.
Une britannique au musée d’Orsay
Bridget Riley exposée à Orsay, dans ces galeries dédiées à Cézanne, Signac ou Van Gogh, a quelque chose de juste. C’est un retour symbolique : une artiste britannique rendant hommage à un peintre français, un siècle plus tard, dans le musée même où se conserve la mémoire du postimpressionnisme. L’exposition suggère ainsi une histoire transnationale de la modernité : de la France scientifique de Seurat à la rigueur conceptuelle de l’Angleterre d’après-guerre, un même désir d’ordre et de lumière traverse le temps.
Riley elle-même l’avoue : « Quand le doute survient, il me suffit de me souvenir de Seurat. Ce que j’ai appris de lui revient sous différentes formes, encore et encore. » Son œuvre entière pourrait se lire comme un commentaire prolongé de cette leçon.
L’œil en éveil
En quittant l’exposition, le regard conserve une vibration. Non celle d’un effet optique, mais celle d’une mémoire visuelle : la certitude que la couleur peut penser, que la perception peut être une discipline, et que l’abstraction n’est pas une fuite mais un approfondissement.
Point de départ ne célèbre pas seulement une rencontre entre deux artistes ; il réaffirme le pouvoir de la peinture à transformer la vision elle-même. Riley, par Seurat, nous apprend à regarder — non les formes, mais ce qui les relie. Dans les galeries d’Orsay, la lumière se propage ainsi d’un siècle à l’autre, comme un fil continu entre science et émotion, rigueur et vertige.
***
(c) Ill. têtière : Bridget Riley, Cataract 2, 1967 © Anna Arca/ © Bridget Riley 2025. All rights reserved

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.


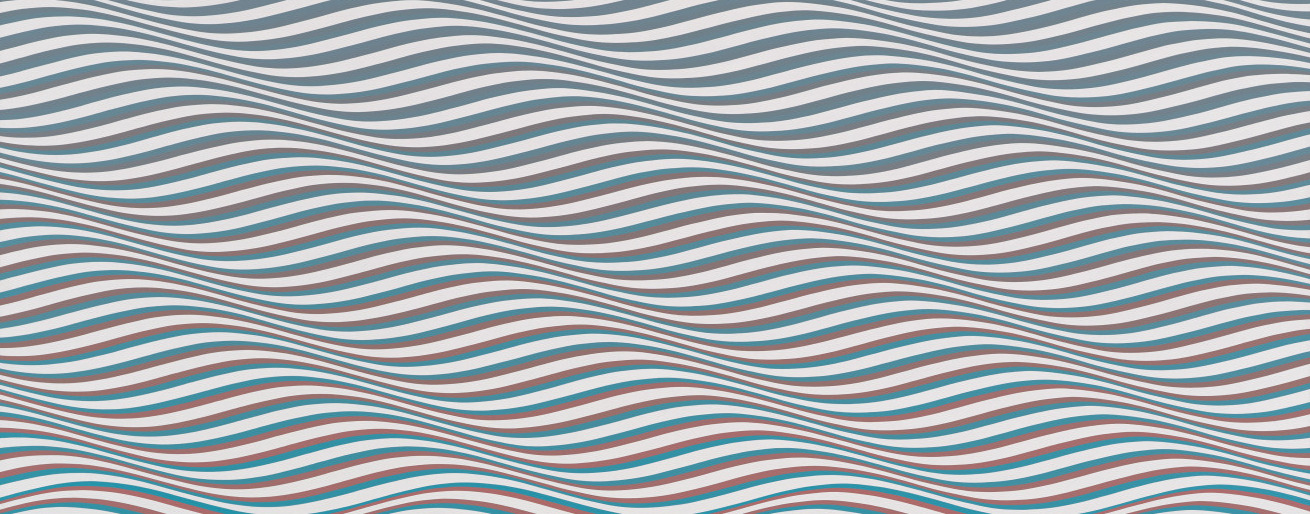











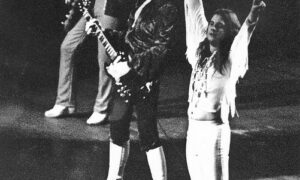





























Commentez cet article de Pr4vd4