Comprendre les enfants HPI présentant des troubles de l’apprentissage (double exceptionnalité) requiert d’appréhender la complexité de leur développement psychique, pris entre leurs capacités exceptionnelles et les défis imposés par leurs difficultés cognitives. Entre les attentes parentales et scolaires, ces enfants vivent souvent une dissonance cognitive et émotionnelle qui peut altérer leur estime de soi et leur relation à l’apprentissage.
L’enfant à haut potentiel intellectuel (HPI), souvent perçu comme un modèle de réussite cognitive, peut parfois présenter une dualité inattendue : celle de conjuguer une intelligence supérieure à la moyenne avec des troubles de l’apprentissage, tels que la dyslexie ou le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Cette situation, nommée « double exceptionnalité », pose un défi considérable tant pour les parents que pour les éducateurs, souvent déconcertés par cette apparente contradiction.
Freud rappelle que l’intellect et l’inconscient sont étroitement liés dans le développement de l’enfant, et il serait naïf de croire que la seule capacité intellectuelle pourrait résoudre les conflits internes auxquels l’enfant doit faire face. Les enfants HPI sont souvent confrontés à des attentes élevées, renforcées par l’admiration sociale et parentale. Cependant, lorsqu’un trouble de l’apprentissage s’ajoute à cette équation, la dissonance entre leur potentiel intellectuel et leurs difficultés académiques crée un terrain fertile pour des conflits psychiques intenses.
La construction identitaire face à la double exceptionnalité

La question de l’identité de l’enfant à double exceptionnalité se pose avec une acuité particulière. L’enfant, conscient de ses capacités intellectuelles mais empêché dans leur pleine expression par des obstacles cognitifs (dyslexie, TDAH, dyspraxie…), vit un déchirement intérieur. La tension entre ce qu’il « sait » qu’il peut accomplir et ce que la réalité scolaire lui renvoie constitue une source de frustration et d’angoisse. Lacan, dans ses écrits sur l’Idéal du Moi, propose que cet enfant soit constamment écartelé entre une image idéalisée de lui-même et la désillusion de ses performances réelles.
Le regard parental, souvent teinté d’admiration pour l’intellect de l’enfant, peut devenir doublement anxiogène dans ces cas. Le paradoxe entre la brillance intellectuelle et les échecs dans des tâches apparemment simples (lecture, écriture, concentration) devient incompréhensible, et les attentes parentales peuvent, inconsciemment, nourrir un sentiment d’insuffisance chez l’enfant. Ce dernier se retrouve alors à vivre sous l’emprise d’un surmoi extrêmement exigeant, chargé de reproches quant à ses incapacités apparentes à atteindre l’idéal qu’on lui attribue. L’enfant à double exceptionnalité peut donc développer une auto-critique sévère, cherchant à compenser ses « faiblesses » perçues par un perfectionnisme exacerbé.
Les conséquences psychiques du paradoxe cognitif
La double exceptionnalité ne se limite pas à une dysharmonie cognitive ; elle a des répercussions directes sur le plan émotionnel et affectif. Comme l’évoque Mélanie Klein, l’angoisse de persécution peut surgir lorsque l’enfant se sent défaillant, non seulement dans les yeux des autres, mais dans sa propre estime. Les difficultés d’apprentissage, loin d’être simplement des obstacles académiques, deviennent des éléments actifs dans la dynamique inconsciente, renforçant des mécanismes de défense comme la répression ou la dévalorisation.
Un enfant HPI, qui possède par ailleurs une sensibilité émotionnelle accrue, peut vivre ses échecs scolaires comme des trahisons profondes de ses compétences innées. Il devient alors essentiel de se demander si ces enfants ne cherchent pas à se protéger psychiquement en rejetant certaines tâches, notamment celles qui confrontent directement leurs difficultés. La relation à l’apprentissage peut devenir ambivalente, marquée par des phases de désinvestissement ou, au contraire, par une obsession à vouloir tout comprendre et maîtriser.
La place de l’école et du soutien familial
La structuration de l’appareil psychique de l’enfant à double exceptionnalité est directement influencée par l’environnement scolaire et familial. L’école, souvent perçue par les enfants HPI comme une institution rigide et normative, peut exacerber le sentiment de décalage. L’enfant comprend rapidement qu’il ne correspond pas aux standards imposés, ce qui alimente un sentiment d’échec. La théorie des attachements de John Bowlby peut éclairer la manière dont ces enfants cherchent des figures rassurantes, que ce soit chez les parents ou les enseignants, capables de contenir leur anxiété et de leur offrir un cadre sécurisant. Mais si les attentes des adultes se révèlent trop rigides ou incompréhensives, l’enfant peut se sentir en insécurité affective, aggravant ainsi ses troubles.

Le rôle de la famille, et plus particulièrement des parents, est ici fondamental. Comprendre que l’enfant à double exceptionnalité ne se définit pas par ses réussites ou ses échecs scolaires, mais par la complexité de son être, permet d’adopter une approche plus nuancée et empathique. Donald Winnicott évoque la notion de « mère suffisamment bonne », celle qui sait reconnaître les besoins singuliers de l’enfant sans imposer des attentes irréalistes. Cela peut se transposer aux parents de l’enfant HPI : l’essentiel réside dans l’accompagnement des potentialités de l’enfant, sans nier ses difficultés.
Vers une intégration psychique de la double exceptionnalité
L’enjeu pour ces enfants est de pouvoir intégrer la coexistence de deux réalités apparemment inconciliables : leur haut potentiel intellectuel et leurs troubles de l’apprentissage. C’est dans cette dialectique que se joue la maturation psychique. Il s’agit d’accepter que la performance intellectuelle n’est pas un absolu, et que l’échec n’est pas un signe de faiblesse, mais bien une composante nécessaire de l’expérience d’apprentissage. Les enfants HPI à double exceptionnalité doivent être encouragés à se réconcilier avec leurs limites, et à envisager leurs difficultés comme des éléments constitutifs de leur parcours, plutôt que comme des failles à éradiquer.
La double exceptionnalité, loin d’être un paradoxe pathologique, peut devenir le lieu d’une réconciliation entre différentes parties du moi, permettant à l’enfant de construire une identité qui ne soit plus scindée entre un idéal inatteignable et une réalité frustrante. C’est là que réside peut-être l’enjeu ultime pour ces enfants : intégrer leur singularité dans une dynamique de croissance psychique, où leurs talents et leurs vulnérabilités coexistent et se renforcent mutuellement.
Lire nos articles du dossier Enfant HPI et approches psy :
- L’investissement intellectuel, défense chez l’enfant HPI
- La construction du narcissisme chez l’enfant HPI
- Les dynamiques familiales autour de l’enfant HPI
- L’enfant HPI face au complexe d’Œdipe
- Intelligence et créativité chez l’enfant HPI
- La précocité intellectuelle de l’enfant HPI
- Enjeux psychiques de la précocité intellectuelle
- L’enfant HPI : une singularité cognitive et émotionnelle
- Enfant HPI et troubles de l’apprentissage

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.



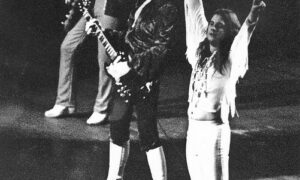































Commentez cet article de Pr4vd4