ON EST CHEZ NOUS ! Cri de ralliement, cri de guerre, cri d’angoisse entendu dans les meetings d’extrême droite, dans les commentaires Facebook ou X saturés de drapeaux tricolores, sur les pancartes des manifestations anti-immigration… Slogan devenu totem, expression supposément évidente, mais qui, à y regarder de plus près, a tout d’un aveu : on clame qu’on est « chez soi » quand on ne s’y sent plus. On veut établir une souveraineté territoriale parce que, intérieurement, on est déjà délogé. Il y a dans cette phrase la brutalité d’un corps qui hurle parce que la tête vacille. Le cri identitaire est aussi un symptôme.
Le « on est chez nous », dans sa performativité la plus primaire, dit la volonté d’expulser. Il ne supporte pas l’ambiguïté. Il vise à définir une frontière nette, un dedans rassurant et un dehors menaçant. Mais sous cette topologie simplifiée, se niche une faille plus profonde, plus intime, que ne masquent ni le tricolore brandi comme une amulette, ni les envolées virilistes d’un discours de campagne. Ce « nous » ne se définit que contre un « eux » mouvant, protéiforme : les migrants, les musulmans, les gauchistes, les métèques, les woke. C’est un « nous » qui se cherche une consistance à l’extérieur de lui-même, faute d’avoir une intériorité stable.
Chez nous : fiction d’un chez-soi introuvable
À y regarder de près, l’expression agit comme un mécanisme de défense. Un déplacement, au sens freudien. L’angoisse interne – celle d’un moi atomisé, disloqué par le néolibéralisme, les mutations sociales, la solitude – est projetée sur une altérité visible. On expulse ce qui gêne dans la rue, faute de pouvoir le faire dans la tête. On affirme un « chez nous » en réaction à un « je suis mal chez moi », chez moi dans mon corps, chez moi dans ma langue, chez moi dans cette époque qui ne me veut plus et me déclasse.
Cette analyse trouve des échos chez nombre d’auteurs qui, sans s’être concertés, ont mis en lumière cette disjonction entre le territoire symbolique et le sujet désorienté. Le sociologue Didier Fassin, dans La force de l’ordre, décrivait déjà comment l’État, en assignant des populations à des espaces illégitimes (banlieues, centres de rétention, zones d’attente), produit un discours sécuritaire qui légitime l’exclusion. Ce que le « on est chez nous » légitime, c’est la violence d’une appartenance sans hospitalité qui me glace [pour info, cela fait la rime avec le paragraphe précédent].
Quand l’extérieur hurle ce que l’intérieur tait
Chez Fabien Truong, les jeunes des quartiers populaires ne répondent pas à cette injonction par un contre-slogan frontal. Ils développent un rapport hybride au territoire, fait de loyautés multiples, de mémoire, de ressentiment et de bricole. Leur « chez soi », ce n’est ni la patrie ni le drapeau, mais un territoire vécu, incarné, une géographie affective plus qu’administrative. Il n’y a rien de pur là-dedans. Et c’est tant mieux.
Pour Françoise Vergès, la dimension coloniale de cette revendication saute aux yeux. Le « chez nous » des anciens colons – devenus aujourd’hui les enfants inquiets d’un Empire révolu – est hanté par l’idée d’une perte. Non pas la perte d’un territoire, mais la perte d’une centralité. Être « chez soi », c’est avoir le pouvoir de définir ce que cela signifie. Dans les sociétés postcoloniales, ce pouvoir se fissure, et la parole de l’Autre s’introduit dans l’espace symbolique. D’où cette panique. D’où cette agressivité.
Houria Bouteldja, dans Les Blancs, les Juifs et nous, déconstruit l’idée même d’un « nous » national innocent. Le « nous » est toujours situé, socialement, historiquement, racialement. Celui du slogan identitaire est un « nous » blanc, masculin, propriétaire. Et ce « chez nous » est une fiction construite pour masquer les violences fondatrices : colonisation, dépossession, exploitation. S’il faut le crier si fort aujourd’hui, c’est peut-être parce qu’il vacille. Le « chez nous » est une forteresse branlante, dont les murs se fissurent à mesure que la conscience historique fait retour.
C’est ce vacillement qui rend la formule aussi nerveuse, aussi saturée d’émotion. « On est chez nous » ne signifie pas : nous sommes en paix chez nous. Cela signifie : nous craignons de ne plus l’être. Le confort symbolique de l’habiter est perdu. On ne vit plus, on campe. Et parfois, pour ne pas entendre le vacarme du dedans, on crie très fort dehors.
Territoires perdus du moi
Il y a donc un lien intime, troublant, entre ce slogan de conquête et une fragilité existentielle. Ce n’est pas un hasard si, dans des témoignages d’électeurs d’extrême droite, revient sans cesse la plainte d’un monde devenu incompréhensible, flou, trop rapide. Ce « je suis mal chez moi, dans ma tête » est rarement formulé aussi clairement, mais il infuse. Il est là, comme une nappe phréatique trouble sous la surface rageuse des plateaux télé. Le « chez nous » crié masque un chez-soi déserté.
La philosophe Vinciane Despret, qui n’a pas écrit directement sur ce thème, invite pourtant à poser cette question précieuse : et si nous interrogions moins ce que veut dire « être chez soi », que ce que cela nous coûte de ne plus l’être ? Ce coût, aujourd’hui, se paie en fantasmes de réappropriation, en replis communautaires, en votes-sanctions. C’est l’intériorité blessée qui réclame des frontières.
« My best friend is an alien (I know him and he is!) »
Et si, finalement, cette parole brute – « on est chez nous » – n’était que la version rudimentaire, brutale, d’un autre énoncé plus silencieux, plus inquiétant : je ne sais plus où j’habite, ni qui je suis, ni ce qu’on me veut ? Une plainte désespérée déguisée en cri de guerre.
***
(c) Ill. têtière : DALL·E 2025-05-10 09.35.54 – A panoramic view of a crumbling, abandoned house on the roadside, with a retro 1970s atmosphere. The house is partially collapsed

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.












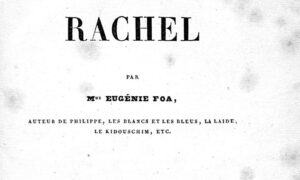



























Commentez cet article de Pr4vd4