On l’invoquait par nécessité, jamais par amour. Arès, dieu de la guerre, incarne moins la gloire des armes que la débauche de sang, la haine sans frein. Portrait d’un dieu dont les excès nous parlent encore.
Dans l’Iliade, Zeus, pourtant père de tant de faiblesses, confesse sa répulsion : il hait Arès plus que tout autre dieu. Athéna, sœur et rivale, le ridiculise régulièrement, le terrassant avec aisance. Même chez les mortels, il ne suscite guère d’élans fervents : on l’honore, faute de mieux, comme on donnerait une obole au bourreau pour qu’il détourne un instant le glaive.
Arès est la guerre sans gloire, sans stratégie, sans intelligence. Là où Athéna incarne l’art du commandement, la discipline et la pensée, lui n’est que fracas, carnage, brutalité. Hésiode l’évoque comme un fléau, Homère le traite de chien enragé* (rien à voir avec « Homère m’a tuer » rassurez-vous). La haine semble lui tenir lieu de raison d’être.
Arès, tueur du violeur de sa fille
Parfois, la fureur se fait acte. Arès tue Halirrhothios, fils de Poséidon, coupable d’avoir voulu violer Alcippe, sa propre fille. Meurtre, certes motivé par un instinct paternel, mais meurtre tout de même. Le dieu doit comparaître devant les siens, sur la colline de l’Aréopage. C’est là, dit-on, que se fonde le tribunal athénien. Arès est donc le premier dieu traduit en justice : symbole d’une violence trop démesurée pour rester impunie, même aux yeux des immortels.
Jouissance de la guerre
Qu’y a-t-il derrière cet appétit de sang ? La mythologie le montre blessé, gémissant comme un enfant sous les coups de Diomède. Arès aime le carnage, mais supporte mal la douleur. Il se complaît dans la haine, mais ignore la bravoure. Il ne cherche pas la victoire, seulement le tumulte, la confusion, le désordre. Son existence même est une répétition de batailles absurdes.
La psychanalyse y verrait l’éruption d’un désir de mort, pulsion sans limite, qui nourrit et dévore celui qui la porte. Arès n’est pas seulement le dieu qui tue : il est celui qui se détruit dans la guerre. Sa brutalité est l’envers de sa fragilité. À travers lui se révèle un besoin d’amour contrarié, retourné en haine. L’ombre d’Éros n’est jamais loin : les Anciens ne s’y trompaient pas en le liant à Aphrodite, compagne improbable mais nécessaire (ça devait pas être drôle tous les jours).
Les faucons d’hier et d’aujourd’hui
Arès, comme demain, ne meurt jamais, car il ressurgit dans chaque époque. Les modernes ont inventé le terme de « faucons » pour désigner les partisans acharnés de la guerre, ceux qui trouvent dans la conflictualité non pas un malheur à conjurer mais une raison d’exister. Les seigneurs de la guerre d’aujourd’hui, qu’ils portent uniforme ou costume-cravate assorti à leur badge de SMP / PMC, incarnent cette même jouissance trouble d’un monde à feu et à sang.
La sociologie de la violence apprend que la guerre, au-delà de ses raisons politiques, devient pour certains un cadre d’existence, un ordre paradoxal, une intensité que la paix ne procure pas. Arès révèle ce vertige : l’horreur devient ivresse, le chaos devient identité.
Arès cache et révèle
Arès n’est pas qu’une simple brute ou un pantin sanglant. Il incarne la part honteuse des sociétés humaines : cette attirance pour la violence qui séduit autant qu’elle effraie. Il est haï, mais indispensable. Sans lui, pas de catharsis, pas de mise en scène de la pulsion destructrice. Arès, en somme, révèle ce que nous ne voulons pas voir : que la guerre n’est pas seulement subie, mais désirée.
La philosophie a souvent cherché à penser l’amour comme force de vie. Arès rappelle que la haine, elle aussi, fonde des mondes, soude des collectifs, offre des identités. Le problème n’est pas qu’il existe, mais qu’il fascine.
***
Homère, L’Iliade
Dans l’Iliade, chant V, vers 31, Homère le qualifie de « fléau des hommes » (ἀνδροφόνον, δαῖμον ὀλοὸν καὶ δαῖμον ὀλέθριον – loutron brotôn selon les manuscrits), un des épithètes les plus négatifs accordés à un dieu.
Toujours dans l’Iliade, chant V, vers 832-833, Zeus s’adresse à Arès après sa blessure infligée par Diomède et Athéna : « Tu es pour moi le plus odieux de tous les dieux de l’Olympe, car tu n’aimes rien tant que querelles, guerres et combats. » Dans certaines traductions (notamment en français par P. Mazon ou en anglais par A.T. Murray), Zeus va jusqu’à parler de lui comme d’un chien sans frein, insatiable de guerre (κύνα λυσσητῆρα = chien furieux, enragé).
Hésiode, Théogonie et Bouclier d’Héraclès
Dans la Théogonie (v. 933-937), Hésiode cite Arès parmi les enfants d’Héra et de Zeus, mais surtout, dans le Bouclier d’Héraclès (v. 439-440), il le présente accompagné de ses enfants : Phobos (la Peur) et Deimos (la Terreur). Ils sèment l’effroi et la mort sur les champs de bataille. Le vocabulaire utilisé associe Arès et sa descendance à un fléau destructeur (λοίγιον), terme qui renvoie à la peste, au désastre, à la ruine.

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.





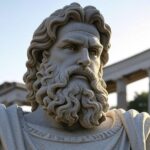








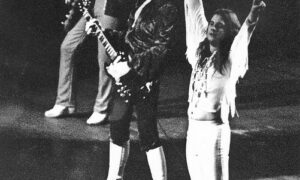





























Commentez cet article de Pr4vd4