La brosse à cheveux semble appartenir au registre des objets discrets, usuels, indifférents. Pourtant, dans la logique des systèmes de consommation décrite par Baudrillard, il ne s’agit jamais seulement d’un instrument fonctionnel, mais bien d’un signe : un objet signifiant, investi de valeurs culturelles, esthétiques et sociales. C’est là tout le paradoxe de la brosse à cheveux, à la fois banale et chargée d’une symbolique qui dépasse son simple usage.
Une technologie de la présentation de soi
Dans la stratification des goûts établie par Bourdieu, les pratiques corporelles révèlent la distinction sociale. Se brosser les cheveux n’est pas une action neutre : elle appartient à une économie du soin de soi qui différencie les groupes sociaux. La nature du peigne ou de la brosse trahit une appartenance : le manche en bois verni d’une brosse artisanale, à poils de sanglier, évoque un souci de raffinement et une culture de la matière noble, là où le plastique bon marché signale une préoccupation fonctionnelle désengagée des enjeux du prestige. L’objet, par sa matérialité, met en évidence une vision du corps comme capital, selon la théorie bourdieusienne du capital culturel et corporel.
Rite de l’intime et du collectif
Mais au-delà de la distinction, la brosse à cheveux inscrit l’individu dans un réseau de pratiques rituelles. Barthes l’aurait peut-être incluse parmi ses mythologies domestiques : elle participe de cette gestuelle silencieuse, transmise de génération en génération, qui mélange héritage et apprentissage. Chez l’enfant, le premier contact avec la brosse maternelle ou paternelle devient une expérience affective, un moment de transmission tactile et d’initiation à la mise en ordre du corps. Ce rituel n’est pas seulement intime : il répond aussi à une norme collective de présentabilité.
La brosse à cheveux est domestication de la nature
« She comes in colors ev’rywhere
She combs her hair
She’s like a Rainbow »
La brosse incarne un geste de domestication, une réduction symbolique du désordre capillaire à l’ordre social. Dans une perspective proche de Foucault, on peut y voir un outil disciplinaire du corps, une normalisation du cheveu sauvage en cheveu civilisé. Se coiffer, c’est s’inscrire dans le biopouvoir, c’est faire acte de conformité aux modèles dominants. La chevelure, chaotique et indisciplinée, devient un espace de maîtrise par le brossage régulier. L’objet met ainsi en tension nature et culture, chaos et ordonnancement, indiscipline et dressage symbolique.
Objet et le fantasme de l’harmonie
Du point de vue psychanalytique, le geste du brossage peut s’interpréter comme une quête d’apaisement. Winnicott a développé la notion d’objets transitionnels : la brosse, par sa répétition gestuelle et son contact matière-peau, participe d’un réconfort primaire. Le plaisir sensoriel du passage de la brosse peut être rapproché des auto-apaisements enfantins, prolongeant un fantasme d’uniformisation et de contrôle sur son apparence.
L’abandon des cheveux : résidu et symbolique du rejet
Les cheveux abandonnés sur la brosse ne sont pas neutres : ils forment un vestige du corps, une trace organique qui interroge notre rapport à l’éphémère et à la perte. Kristeva aurait pu y voir une forme d' »abject » : ni tout à fait soi, ni tout à fait autre, ces cheveux perdus représentent un fragment du moi qui doit être écarté pour préserver l’intégrité du sujet. Dans l’entretien de la brosse, dans ce geste répétitif consistant à en retirer les cheveux, s’exprime une forme de rituel purificateur, une volonté d’effacer l’empreinte du temps et de maintenir la fonction de l’objet dans son efficacité immédiate.
La brosse à cheveux ne se réduit donc pas à un simple instrument d’hygiène. Elle est une interface entre l’individu et le social, un médiateur symbolique entre nature et culture, un outil disciplinaire et un objet de réconfort. Comme tout artefact du quotidien, elle porte en elle l’histoire des corps et des normes, des mythologies et des distinctions. Ainsi, l’acte de se brosser les cheveux est un rituel d’inscription dans l’ordre symbolique du monde, où le moindre geste recèle une stratégie, un habitus, une discipline, un fantasme.
***
(c) Ill. têtière : photo de Yan Krukau

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.








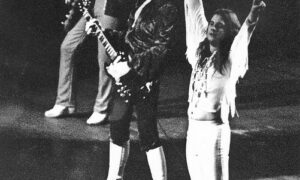





























Commentez cet article de Pr4vd4