Le papier toilette fait partie de ces objets qui, bien qu’omniprésents dans la vie quotidienne, restent dans l’angle mort de la conscience collective. Pourtant, loin d’être un simple accessoire fonctionnel, il constitue un véritable objet social au sens où l’entend Jean Baudrillard : un produit qui, au-delà de sa valeur d’usage, revêt des significations profondes et souvent inconscientes.
Son existence même est marquée par une tension paradoxale : il est indispensable, mais doit rester caché. La pudeur qui entoure son usage dépasse la simple fonction corporelle et renvoie à ce que Georges Bataille décrit comme le champ du « bas matériel », cet espace où se jouent à la fois la souillure et l’ordre social.
Une (ou plusieurs) couche(s) de stratification sociale
« Quand y’a pas d’papier, une seule solution… »
Loin d’une homogénéité républicaine, le papier toilette est le lieu d’une mise en scène de la distinction sociale au sens de Pierre Bourdieu. Le choix entre un papier double ou triple épaisseur, un rouleau basique ou parfumé, un modèle avec motifs ou uni, relève d’un goût socialement situé.
Le PQ de supermarché premier prix traduit une relation pragmatique et nécessaire à l’objet, tandis que les papiers enrichis d’aloé vera ou de senteurs florales manifestent une volonté de transformer un acte banal en moment de bien-être. Dans les classes supérieures, le choix du papier toilette répond à un double enjeu : une distinction discrète (le confort subtil) et un engagement symbolique (la recherche de produits écologiques ou recyclés).
Un fétiche moderne entre propreté et angoisse
La blancheur immaculée du papier toilette n’est pas un hasard. Comme le montre Mary Douglas dans De la souillure, les sociétés tendent à ritualiser la gestion des excrétions, et la blancheur est ici le signe d’un absolu sanitaire, garantissant l’absence de toute trace de souillure.
Cette obsession de la pureté rappelle l’angoisse du « corps poreux » théorisée par Julia Kristeva dans Pouvoirs de l’horreur. Le PQ est un objet-limite : il marque la frontière entre le corps propre et le déchet, entre soi et ce qui doit être éloigné. Sa consommation en temps de crise (pénurie pendant la Covid-19) témoigne d’une angoisse existentielle face à la perte de contrôle.
Le geste invisible : automatisme et rituel social
Si l’objet papier toilette est caché, le geste qui l’accompagne l’est encore plus. L’acte d’essuyage, d’apparence anodine, est à la fois un automatisme et un rituel social intériorisé dès l’enfance. Il appartient au domaine de ce que Marcel Mauss appelait les « techniques du corps » : des gestes acquis culturellement, dont l’exécution est si profondément ancrée qu’elle en devient imperceptible.
« Le PQ, comme tout objet, est avant tout un miroir de la société qui l’emploie »
Le geste du papier toilette est aussi codifié que tabou. Son invisibilisation participe à une logique de refoulement freudien : il est l’acte nécessaire qui efface la souillure, lui-même devant disparaître immédiatement. Ce rituel participe à la construction de l’ordre symbolique du corps propre et du corps social. En ce sens, il rappelle l’analyse d’Erving Goffman sur la mise en scène de soi : le geste est effectué dans un espace privé, à l’abri des regards, car sa révélation serait perçue comme une transgression majeure des normes de la décence.
Or, si ce geste est ainsi condamné à l’invisibilité, c’est aussi parce qu’il touche à une dimension fondamentale de l’ordre symbolique. Toute transgression de cette discrétion entamerait la frontière entre l’intime et le public, entre l’acceptable et l’indicible. Cette tension trouve un prolongement dans l’économie du simulacre, où la matérialité du papier toilette se dilue dans des représentations détourné
Economie du simulacre (au bout du rouleau ?)
Roland Barthes aurait pu voir dans le papier toilette un « mythe moderne » : il est chargé d’une fonction qui dépasse son rôle premier. L’idée même qu’il puisse être absent est insupportable, comme si la rupture de cette chaîne symbolique menaçait l’ordre du monde.
Dans les sociétés capitalistes avancées, le PQ est également un pur produit du simulacre baudrillardien (Simulacres et simulation). Détourné en objet de luxe (or, soie, parfum) ou de marketing (sous forme humoristique ou politique), il devient un signe vidé de sa fonction première et réinvesti d’un imaginaire consumériste.
Trivial en apparence, le papier toilette condense pourtant en transparence des enjeux enfouis : marqueur social, fétiche hygiénique, mythe moderne. Il articule nos représentations du corps, de la pureté, et de l’ordre symbolique. Sa disparition ou sa transformation révèlent nos anxiétés les plus profondes, rappelant que, comme tout objet, il est avant tout un miroir de la société qui l’emploie.
***
(c) Ill. têtière : Photo de Sadi Hockmuller

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.












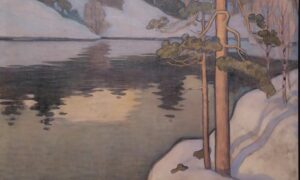







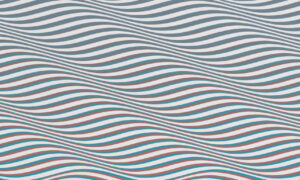


















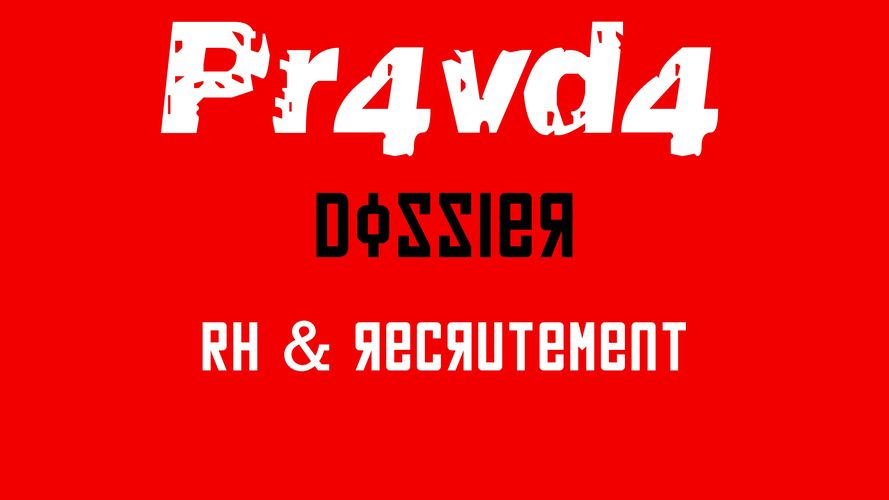
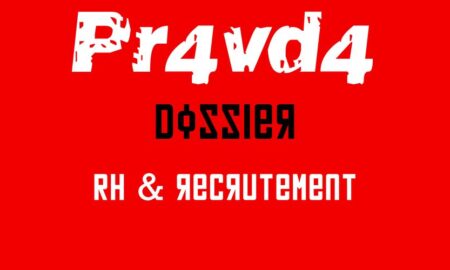



Commentez cet article de Pr4vd4