Faire la part des choses, c’est tenter d’habiter l’espace fragile entre la condamnation et la complaisance, entre la compréhension et l’aveuglement. Cette expression ancienne, presque triviale dans son usage courant, révèle pourtant un enjeu profondément moderne : celui de la justesse du jugement dans un monde saturé d’émotions, d’informations et de postures.
Faire la part des choses, ce n’est pas donc seulement séparer le bien du mal, mais discerner dans la confusion — discerner, c’est-à-dire juger sans mutiler.
Les fondements d’un discernement incarné
Faire la part des choses suppose d’abord d’admettre la pluralité du réel. Tout événement, toute œuvre, toute personne se compose d’éléments hétérogènes, parfois contradictoires, que seule la pensée lente et dialogique peut appréhender. Or, notre époque est dominée par la tentation du binaire : aimer ou détester, croire ou rejeter, idolâtrer ou annuler. Dans les affaires Depardieu ou PPDA, l’espace du discernement se trouve piégé entre deux impératifs : la nécessaire reconnaissance des victimes et la crainte du déni d’humanité de l’accusé. Faire la part des choses n’est pas neutraliser le débat moral, mais refuser le simplisme.
Ce geste s’apparente à un travail herméneutique : interpréter sans imposer une lecture unique. Une œuvre, un acte, un individu ne se donnent jamais d’un seul bloc, mais par couches, tensions et contradictions. L’évaluation devient alors un exercice de contextualisation — un art de la nuance plutôt qu’un tribunal de l’instant.
La complexité du sujet : entre masques et répétitions
Ce discernement suppose aussi de reconnaître la complexité du sujet humain. L’homme n’est pas unifié : il est traversé par des pulsions, des rôles, des contradictions. La répétition des accusations médiatiques crée l’illusion d’un « tout cohérent », alors qu’elle masque la différence de chaque acte, de chaque situation, de chaque parole. Ce n’est pas tant la vérité qu’on cherche à établir que la cohérence d’un récit social.
Dans la perspective psychologique, faire la part des choses revient à accepter que le Moi soit un théâtre de tensions — et que juger l’autre implique de se confronter à sa propre fragmentation. Dans la répétition médiatique, dans le « feuilleton » de l’affaire Jubillar, l’individu disparaît derrière le spectacle de la culpabilité ou de l’innocence. Le public, saturé de récits, ne distingue plus le réel de sa mise en scène. La part des choses se perd alors dans la logique de la répétition, où la différence, comme l’aurait dit Deleuze, s’épuise sous le masque du même.
La séduction du jugement et la fatigue de la nuance
La société hypermédiatique a déplacé le centre de gravité du jugement : il ne s’agit plus de penser, mais de ressentir. La logique de la séduction et de l’émotion, analysée par Lipovetsky, s’est infiltrée jusque dans la morale. Nous ne jugeons plus avec la raison, mais avec l’affect. Chaque scandale devient une scène, chaque personnalité un personnage.
Dans ce théâtre global, « faire la part des choses » demande un effort de résistance : refuser l’immédiateté, supporter l’incertitude, différer le verdict. Comme le souligne Hartmut Rosa, la résonance véritable ne naît que là où le monde résiste à notre emprise. Juger sans posséder, comprendre sans excuser, écouter sans adhérer : voilà la tâche la plus difficile. Faire la part des choses, c’est reconnaître cette résistance du monde — et l’habiter sans la dissoudre dans la facilité du jugement tranché.
Le vertige éthique de l’extrême
Mais l’expression se heurte à ses limites face à l’horreur. Peut-on faire la part des choses avec Eichmann ? Arendt a montré que le mal absolu pouvait naître d’une absence de pensée, d’un conformisme administratif. Ici, « faire la part des choses » ne signifie pas accorder la moindre indulgence, mais distinguer entre la monstruosité des actes et la banalité du fonctionnaire.
Ce discernement, loin de diluer la faute, en éclaire la genèse : il montre comment le crime s’inscrit dans une structure, un langage, une logique de l’obéissance. C’est la part tragique de la pensée : comprendre sans justifier, analyser sans absoudre. La part des choses devient ici la part du tragique, celle qui oblige à penser là où la simplification morale voudrait simplement condamner.
La part de l’humain
Au fond, « faire la part des choses » revient à faire la part de l’humain — ni ange ni bête, ni pur ni impardonnable. C’est affirmer que juger, c’est toujours aussi se juger soi-même : reconnaître nos propres aveuglements, nos propres séductions. Là où les réseaux sociaux réclament des verdicts, la pensée réflexive réclame du silence. Là où la foule exige une pureté, la conscience exige de la complexité. Faire la part des choses, c’est tenir dans ce tremblement.
***
(c) Ill. têtière : DALL·E 2025-10-23 14.27.12 – Panoramic modern pop art digital illustration symbolizing the philosophical idea of « faire la part des choses ».

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.


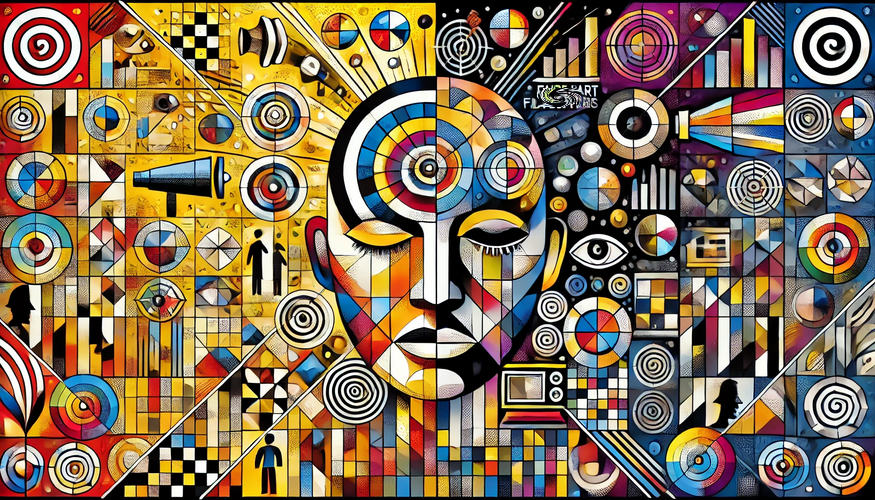










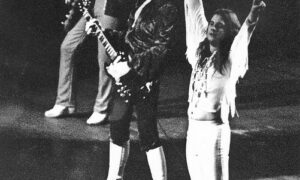





























Commentez cet article de Pr4vd4