Avec Auschwitz-Birkenau vu par Raymond Depardon, le Mémorial de la Shoah poursuit sa réflexion sur les usages de l’image face à l’irreprésentable. Quarante-cinq ans après avoir photographié les lieux pour Paris Match, Depardon accepte pour la première fois de montrer l’ensemble de cette série. Une exposition silencieuse et saisissante, qui entre en résonance avec notre précédent article consacré aux images prises par les bourreaux.
Ce n’est pas une exposition sur la mémoire, ni même un acte de témoignage. Auschwitz-Birkenau vu par Raymond Depardon est plutôt le récit d’une confrontation. En 1979, le photographe alors tout juste passé de l’agence Gamma à Magnum est envoyé à Auschwitz par Paris Match. Ce qu’il rapporte de ce séjour hivernal dépasse la commande : 77 planches-contact, des vues fixes et dépourvues de toute présence humaine, captées sous la neige, avec une rigueur méthodique et une pudeur manifeste. Ces images, jamais exposées jusque-là, forment aujourd’hui un corpus rare. Il ne s’agit pas d’un document d’histoire. Il s’agit d’un regard.
Ce regard-là ne cherche pas à interpréter, encore moins à illustrer. À l’opposé des images d’archives produites par les nazis, analysées dans une précédente exposition du Mémorial (Comment les nazis ont photographié leurs crimes), ici, aucune volonté de contrôle ni d’esthétisation de l’horreur. Depardon ne reconstruit rien, ne met rien en scène. Il visite. Il avance lentement, cadre serré, cadrage large, répétant les prises. Il « brackette », comme il dit, c’est-à-dire qu’il mitraille, sans trop savoir pourquoi, sinon peut-être pour surmonter le malaise.
Une photographie du vide, de la neige et du silence
Ceci est une vidéo avec Raymond Depardon 😉
Ce qui saisit d’emblée, c’est l’absence. L’inhumanité des lieux est redoublée par l’absence de corps. Seule la neige, ce manteau blanc neutre, dépose une forme d’uniformité visuelle sur les barbelés, les baraquements, les miradors. Dans la série Clôtures, les lignes métalliques paraissent désaffectées, presque banales ; dans Coupole d’entrée, c’est l’architecture elle-même qui semble devenir abstraite, sans usage, sans fonction. Pourtant, tout est là, dans ce paradoxe : le site est vide, et l’on n’a jamais autant perçu la densité de ce qu’il recèle.
Depardon photographie ce qu’il appelle « un décor de cinéma », mais il le fait à contre-emploi, refusant tout effet. Il ne cherche pas à faire peur ni à émouvoir, encore moins à esthétiser. Il cadre. Il répète. Il documente, tout en sachant que la photographie n’enregistrera pas l’innommable, seulement ce qu’il en reste. Les images du Crématoire II ou de la Chambre à gaz sont saisies avec cette distance éthique : pas d’effroi spectaculaire, mais une frontalité nue, une économie de moyens qui ne produit ni spectaculaire ni compassion immédiate.
Le parcours de l’exposition est construit avec cette même retenue. On y découvre l’intégralité du reportage, publié partiellement à l’époque dans Paris Match et d’autres titres internationaux. Les planches-contacts y sont présentées comme des objets de travail, soulignant la logique de la série plus que l’icône isolée. Les titres des images sont sobres : Portail, Rails, Fenêtres. Le silence est partout.
Depardon revient vingt ans plus tard sur les lieux, cette fois avec Claudine Nougaret et leurs deux fils. Ce retour, dit-il, était nécessaire. Il ne photographie pas à ce moment-là. C’est un geste de transmission, une présence discrète. Comme il le confie dans l’entretien publié à l’occasion de l’exposition, il ne savait pas vraiment comment faire, ni comment se tenir face à ce lieu. « Je me serais assis, et je n’aurais rien fait », dit-il. Il n’a pas cédé à cette tentation : il a travaillé, chaque jour, photographiant sans cesse, comme pour s’obliger à tenir debout.
Et c’est peut-être cela, au fond, qu’offre cette série : une manière de se tenir. Sans effet, sans discours. L’exposition fait ainsi écho aux principes du cinéma direct que Depardon a longtemps pratiqués : « moins tu bouges, plus on écoute », dit-il. Ici, le photographe est à l’arrêt, les lieux aussi. Tout est figé, mais rien n’est mort. C’est dans le vide que se creuse la possibilité d’une écoute.
La photographie, pour Depardon, n’est ni mémoire ni preuve. Elle est, dit-il, « un aller-retour ». Une tension entre le présent et l’absence, entre le monde tel qu’il est et celui que les images rendent possible. C’est aussi une manière de ne pas refermer l’histoire. De laisser ces lieux ouverts, non comme des sanctuaires, mais comme des espaces où chacun, aujourd’hui encore, est convoqué à revenir.
***
(c) ill. têtière : Pr4vd4 – pour des raisons de droits, nous n’avons pas repris dans cet article des photos de Raymond Depardon. Ces clichés ont été réalisés par la rédaction, en décembre 2016.

Ceci n’est pas une photo de Raymond Depardon. Voir crédits en bas de page.

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
















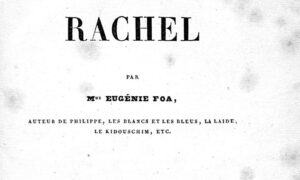



























Commentez cet article de Pr4vd4