Dans l’univers apparemment banal des pratiques quotidiennes, Michel de Certeau éclaire avec une profondeur inattendue les gestes rituels qui peuplent nos interactions sociales. Les vœux de nouvelle année, cet échange codifié de souhaits entre individus, constituent un terrain privilégié pour comprendre sa théorie du « braconnage » et sa distinction entre « stratégies » et « tactiques ». Ces concepts permettent d’analyser comment ce rituel apparemment immuable est en réalité investi et transformé par ceux qui le pratiquent.
Les vœux : une stratégie sociale
De Certeau définit les « stratégies » comme des dispositifs imposés par les institutions pour organiser et contrôler les interactions. Les vœux de nouvelle année relèvent, à première vue, de ce registre : un rituel régi par des conventions langagières, des normes sociales et des attentes culturelles. Le calendrier, outil de structuration collective, impose une temporalité fixe à cette pratique. À l’instar des cartes de visite ou des formules de politesse, les vœux semblent être un acte formel, conformiste, et parfois vide de sens.
En effet, ces échanges ritualisés participent à l’économie symbolique des relations sociales : ils réaffirment les liens existants, marquent l’appartenance à une communauté et respectent les hiérarchies implicites. Ainsi, les vœux structurent le tissu social tout en réaffirmant les règles de l’ordre établi.
La tactique du braconnage : réinventer l’imposé
Cependant, dans la vision de Certeau, l’homme ordinaire n’est jamais un simple exécutant des stratégies institutionnelles. Par le « braconnage », il s’approprie les dispositifs imposés pour les transformer selon ses propres aspirations, besoins et créativités. Les vœux de nouvelle année ne font pas exception.
Dans la pratique, les individus réinterprètent les codes à travers des gestes subtils : une tournure de phrase originale, une carte de vœux faite maison, ou un message humoristique envoyé à minuit pile. Ces détournements transforment un rituel imposé en une opportunité de manifester leur singularité. Ainsi, les vœux deviennent un espace de création personnelle et d’échange véritable, loin du simple conformisme social.
Les médias numériques accentuent encore cette dimension tactique. L’utilisation de GIF, de mèmes ou de messages vocaux personnalisés illustre comment les individus bricolent les outils à leur disposition pour réinscrire leur subjectivité dans un cadre préformaté.
Une poétique de l’ordinaire
Dans cette perspective, les vœux de nouvelle année ne sont plus seulement un rituel imposé par la tradition, mais un acte poétique. Par de petites variations, chaque individu investit ce geste d’une signification propre, faisant de l’ordinaire un lieu d’expression et de résistance silencieuse.
Pour de Certeau, c’est dans ces pratiques discrètes que se joue une part essentielle de la vie sociale. L’analyse des vœux de nouvelle année éclaire ainsi son approche : l’ordinaire n’est jamais insignifiant, mais bien le terrain fertile d’une créativité permanente.
Ainsi, en mobilisant les concepts de Michel de Certeau, les vœux de nouvelle année apparaissent comme un espace hybride, entre stratégie et tactique, où chacun braconne les codes pour y inscrire sa singularité. Ce rituel révèle l’art subtil par lequel les individus transforment l’imposé en une œuvre discrète de réinvention quotidienne.
A lire dans notre dossier Vœux de nouvelle année & philosophie, sociologie et sémiologie
- Jean Baudrillard décrypte les vœux de la nouvelle année comme un simulacre social, reflet d’un futur incertain et d’un langage ritualisé.
- Michel Foucault considère les vœux comme un dispositif de pouvoir, où le langage structure les relations sociales et impose des normes.
- Pierre Bourdieu dévoile les vœux comme un rituel social reproduisant des habitus, entre stratégies symboliques et reproduction des structures de pouvoir.
- Roland Barthes explore la rhétorique des vœux, entre mythe contemporain et codes sociaux façonnant nos souhaits de bonheur.
- Jacques Derrida considère les vœux comme un jeu d’indécision, où sincérité et différance brouillent les lignes entre intention et interprétation.
- Emmanuel Levinas éclaire les vœux comme un acte éthique d’ouverture à l’autre, où la responsabilité envers autrui se manifeste dans la simplicité des mots.
- Jean-Paul Sartre : les vœux deviennent un acte d’engagement existentiel, un geste de liberté projeté dans l’avenir et l’affirmation d’un possible pour autrui.
- Michel de Certeau explore les vœux comme un « braconnage » quotidien, où chacun réinvente ce rituel imposé pour y inscrire sa singularité.

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.




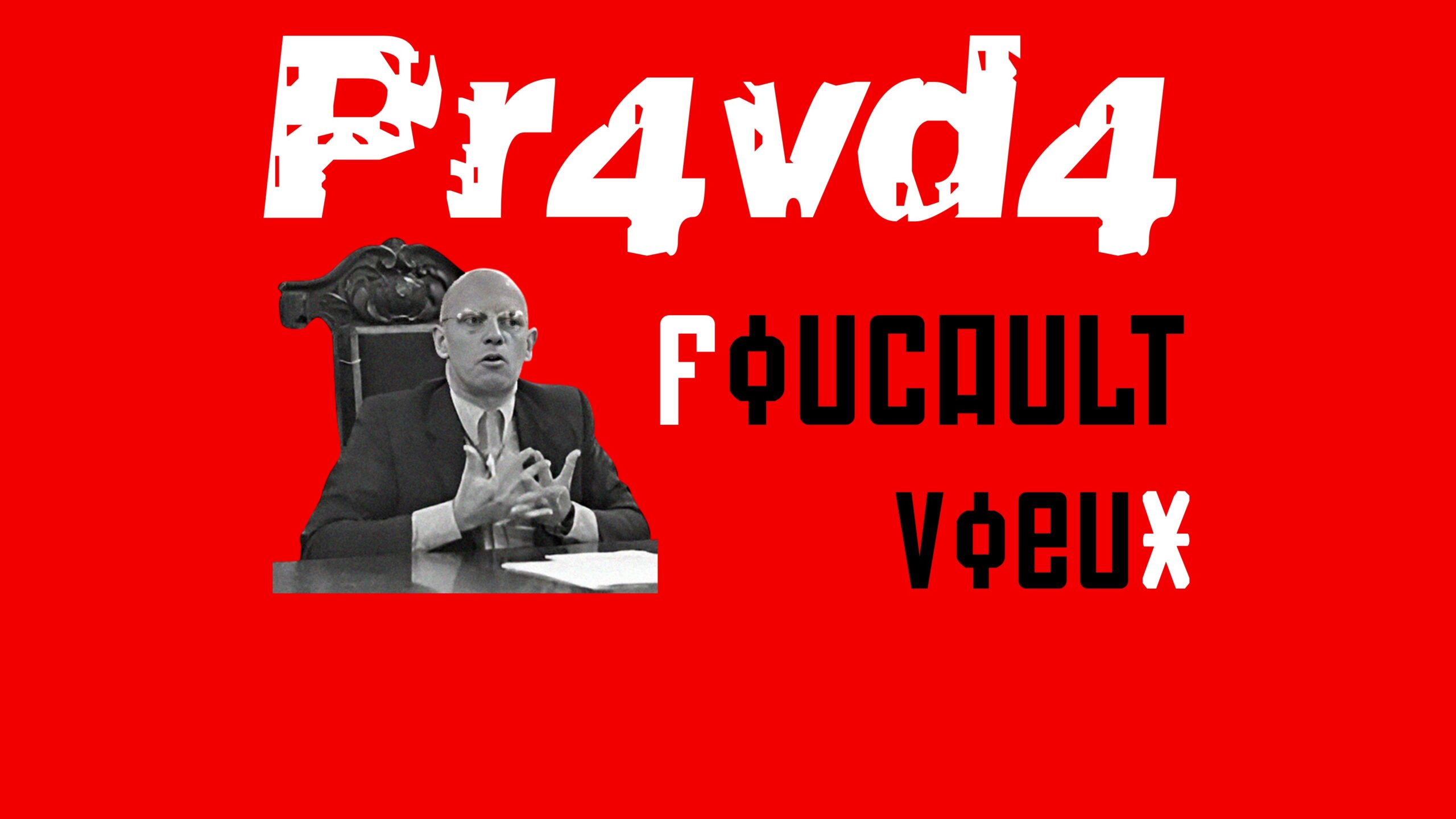



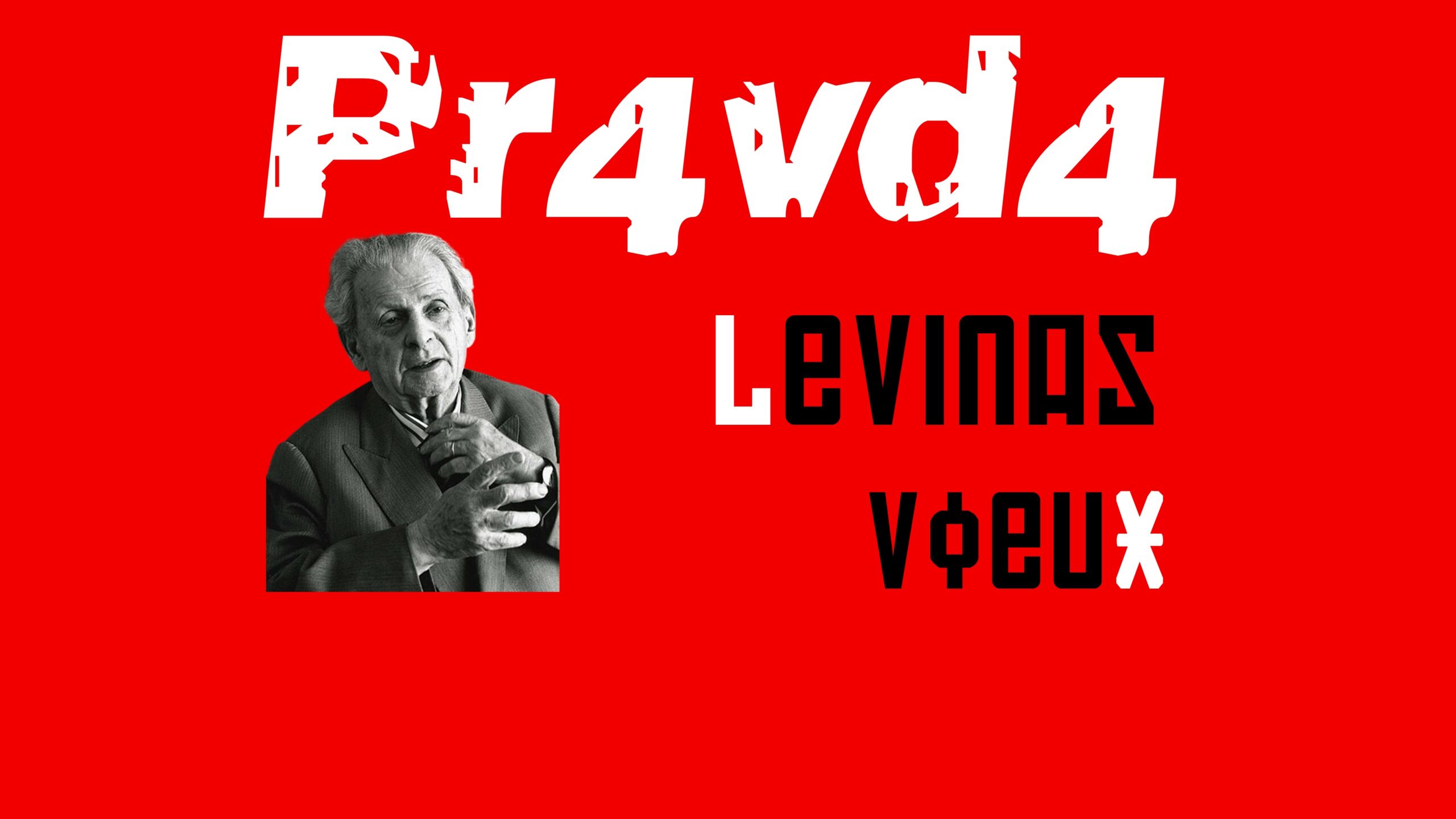




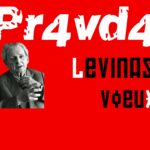
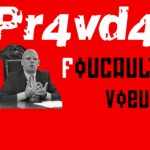




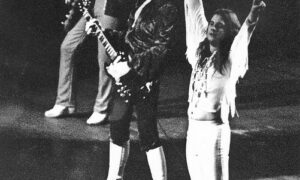































Commentez cet article de Pr4vd4