Pour Jacques Derrida, les vœux de la nouvelle année, cet acte apparemment anodin et répétitif, sont un lieu privilégié où s’entrelacent les grandes questions de la différance, de la trace et de l’impossible. Les vœux ne sont pas ce qu’ils prétendent être – une simple projection bienveillante vers l’avenir – mais une écriture complexe où l’avenir, toujours à venir, s’échappe dans l’indécidable. Derrida ne manquerait pas de souligner que les vœux relèvent d’une promesse qui ne peut jamais se réaliser pleinement, un « je te souhaite » qui demeure hanté par sa propre impossibilité.
L’écriture des vœux : entre présence et absence
Dans la logique derridienne, les vœux sont d’abord un texte, une écriture, qu’ils soient parlés, écrits ou numériques. Mais cette écriture n’est jamais présente à elle-même : elle porte en elle une absence fondamentale. Lorsque je dis « Bonne année », je ne fais que tracer un désir pour un avenir que je ne maîtrise pas. Le vœu est une trace, un signe qui diffère son propre accomplissement et se déplace dans l’infinité de l’avenir.
Cette différance – à la fois écart et différé – révèle que les vœux ne sont jamais tout à fait ce qu’ils disent être. Le futur qu’ils appellent est déjà contaminé par l’incertitude et le passé. En écrivant ou prononçant des vœux, je me trouve pris dans une tension entre une intention sincère et l’impossibilité d’une garantie : puis-je vraiment promettre à l’autre une bonne année, un bonheur, une santé ?
La promesse aporétique
Les vœux relèvent de ce que Derrida nommerait une « promesse aporétique ». En formulant des vœux, je fais un acte d’ouverture vers l’avenir, une tentative de conjurer l’incertitude. Mais cette promesse est immédiatement confrontée à son impossibilité : je ne contrôle ni le temps, ni l’existence, ni l’avenir d’autrui. Ainsi, dire « Je te souhaite une bonne année » est une promesse qui, déjà en acte, échoue à tenir ce qu’elle annonce.
Pourtant, cet échec n’annule pas la valeur des vœux : au contraire, il les rend d’autant plus riches. Derrida aurait souligné que dans cette promesse impossible réside une ouverture radicale à l’autre, une manière de dire : « Je ne sais pas ce que l’avenir te réserve, mais je t’adresse, malgré tout, mon désir qu’il soit bon. » Les vœux deviennent alors un geste d’hospitalité envers l’inconnu, une manière d’accueillir un avenir qui excède toute maîtrise.
Les vœux comme dispositif différant
Les vœux, dans leur ritualité, fonctionnent comme un dispositif différant : ils se répètent chaque année, mais jamais de la même manière. Derrida insisterait sur le fait que chaque vœu, bien qu’il semble s’inscrire dans une tradition codifiée, est singulier. Il est adressé à un autre unique, dans une circonstance unique, et porte en lui la trace de cette altérité.
Cependant, cette singularité est toujours contaminée par la généralité du langage. Lorsque je formule mes vœux, je le fais à travers des mots qui m’échappent, des formules communes, des clichés (« Bonne année, bonne santé »). Ces formules sont des structures différantes, des répétitions qui ne se répètent jamais tout à fait de la même manière, mais qui portent en elles une mémoire collective du rituel.
La machine des vœux : entre technique et humanité
À l’ère numérique, les vœux prennent une dimension nouvelle que Derrida aurait analysée sous l’angle de la technologie et de la spectralité. Les cartes virtuelles, les messages automatiques, les publications sur les réseaux sociaux transforment les vœux en un processus machinique. Le « je te souhaite » devient parfois une fonction programmée, une notification standardisée.
Mais Derrida aurait vu dans cette machinisation une intensification de l’indécidable : qui est véritablement l’auteur du vœu ? Est-ce la machine qui transmet, l’individu qui programme, ou le langage lui-même, toujours déjà autonome ? Les vœux numériques sont hantés par leur spectralité : ils se déplacent dans des espaces virtuels, adressés à des destinataires parfois absents, qui les recevront dans un temps différé. Cette spectralité renforce l’idée que les vœux ne sont jamais complètement présents : ils flottent entre l’intention et la technique, entre le sujet et l’outil.
Les vœux comme don impossible
Pour Derrida, les vœux pourraient également être analysés comme une forme de don – mais un don qui s’inscrit dans l’aporie du don pur. En formulant des vœux, je donne quelque chose à l’autre : une parole, un désir, une attention. Mais ce don n’est jamais pur, car il porte en lui une demande implicite de reconnaissance. Lorsque je souhaite « Bonne année », je suis pris dans une logique de réciprocité : j’attends souvent un retour, un « Et toi aussi ! » qui me renvoie à ma propre position dans l’échange.
Derrida aurait souligné que la pureté des vœux réside précisément dans leur impossibilité de se détacher complètement de cette logique. Ils sont un don contaminé, toujours déjà compromis par l’économie des échanges sociaux, mais c’est dans cette contamination qu’ils trouvent leur force : une manière d’exister dans l’ambiguïté de l’adresse et de l’accueil.
Les vœux, écriture de l’à-venir
Les vœux de la nouvelle année, pour Derrida, ne sont jamais un simple rituel ou une formule figée. Ils sont une écriture complexe où se joue la différance, un texte adressé à l’autre et à l’avenir, mais toujours marqué par son propre retrait. Ils incarnent une promesse impossible, une ouverture vers un à-venir qui ne se laisse jamais entièrement saisir.
Dans leur indécidabilité, les vœux rappellent que toute relation à l’autre est traversée par l’altérité, par une éthique de l’accueil et par une hospitalité radicale. Ils sont une trace fragile, mais persistante, de l’effort humain pour dire quelque chose à l’autre, même lorsque le langage échoue à combler l’écart entre nous. Les vœux ne sont ni pleinement présents, ni pleinement absents : ils dansent à la frontière de l’être et du non-être, dans cet espace indécidable où l’humanité cherche à se dire, encore et toujours.
A lire dans notre dossier Vœux de nouvelle année & philosophie, sociologie et sémiologie
- Jean Baudrillard décrypte les vœux de la nouvelle année comme un simulacre social, reflet d’un futur incertain et d’un langage ritualisé.
- Michel Foucault considère les vœux comme un dispositif de pouvoir, où le langage structure les relations sociales et impose des normes.
- Pierre Bourdieu dévoile les vœux comme un rituel social reproduisant des habitus, entre stratégies symboliques et reproduction des structures de pouvoir.
- Roland Barthes explore la rhétorique des vœux, entre mythe contemporain et codes sociaux façonnant nos souhaits de bonheur.
- Jacques Derrida considère les vœux comme un jeu d’indécision, où sincérité et différance brouillent les lignes entre intention et interprétation.
- Emmanuel Levinas éclaire les vœux comme un acte éthique d’ouverture à l’autre, où la responsabilité envers autrui se manifeste dans la simplicité des mots.
- Jean-Paul Sartre : les vœux deviennent un acte d’engagement existentiel, un geste de liberté projeté dans l’avenir et l’affirmation d’un possible pour autrui.
- Michel de Certeau explore les vœux comme un « braconnage » quotidien, où chacun réinvente ce rituel imposé pour y inscrire sa singularité.

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.




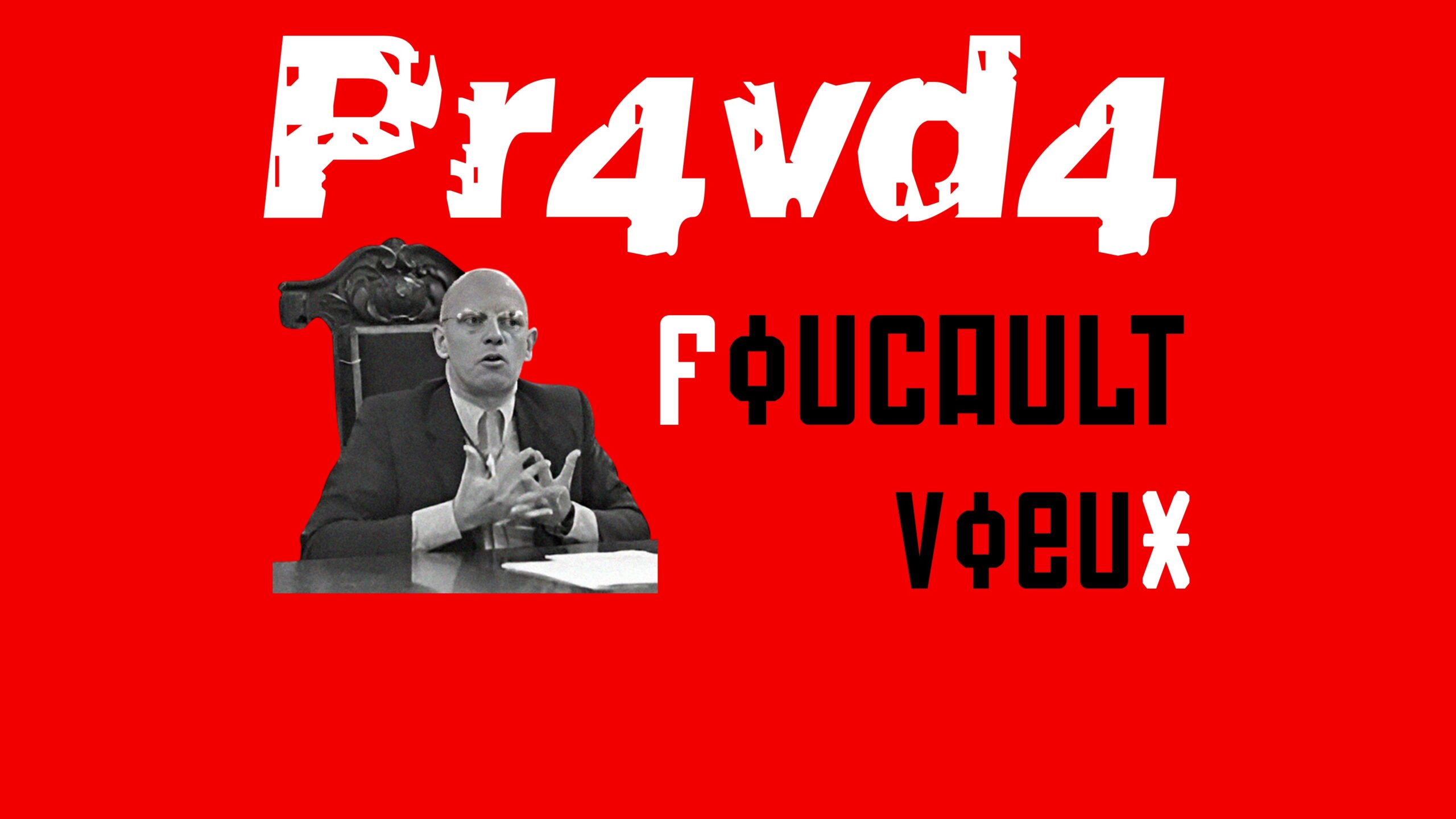


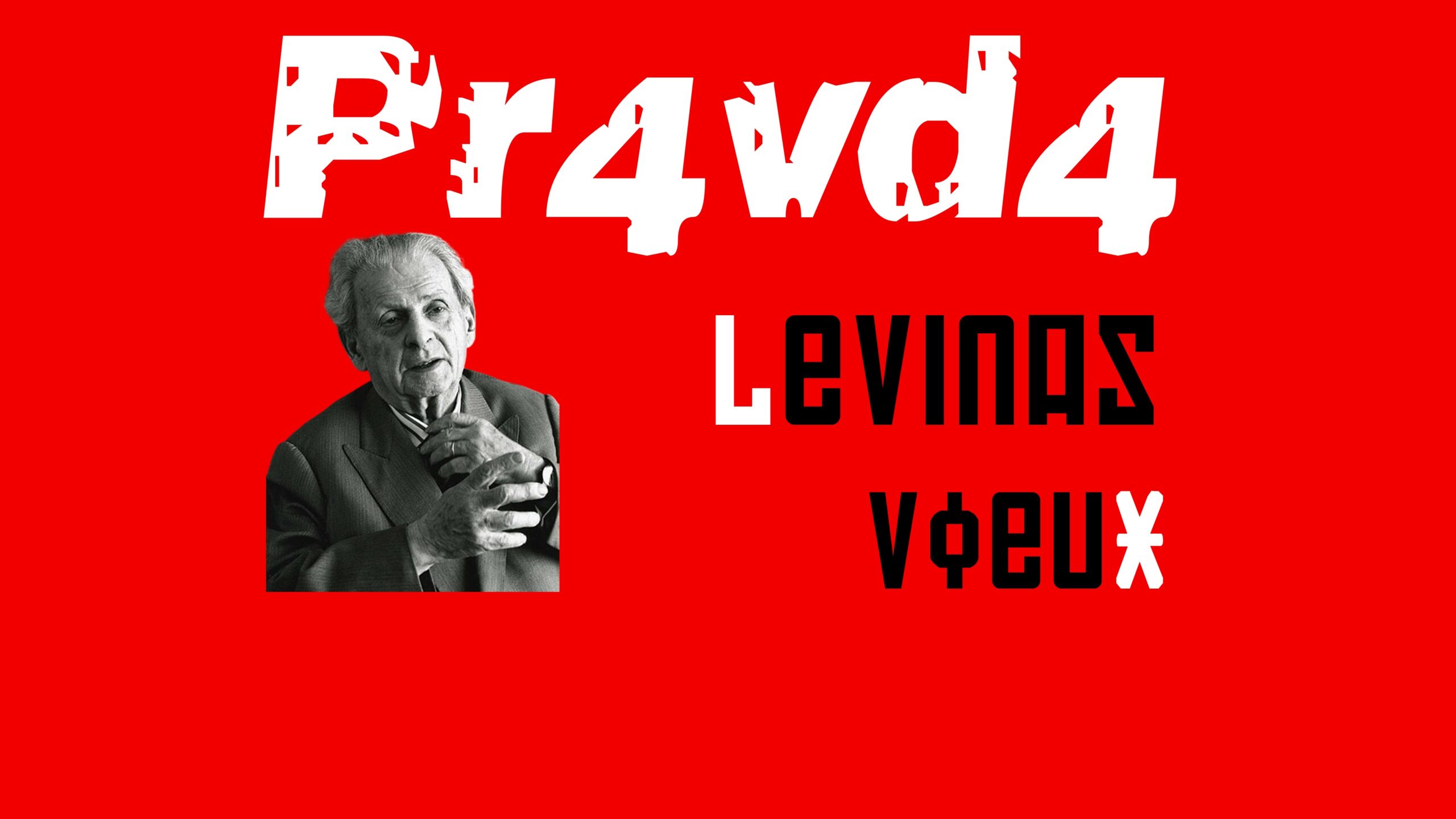




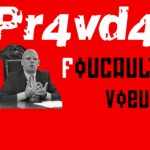
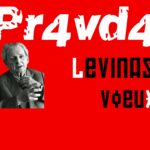



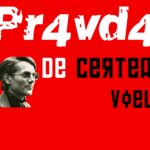



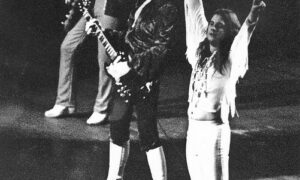





























Commentez cet article de Pr4vd4