Dans la vaste constellation des figures contemporaines du travail, le coach en entreprise occupe une position singulière, à la fois omniprésente et insaisissable. Sous son apparente banalité professionnelle se cache pourtant un condensé saisissant des angoisses organisationnelles, des rituels de pouvoir et de la quête perpétuelle d’efficience qui caractérisent notre époque.
Comme Michel Foucault l’aurait sans doute analysé dans ses travaux sur les dispositifs de pouvoir, le coach n’est pas un simple prestataire de service : il est un signe culturel, un instrument de normalisation, une frontière entre le rationnel et l’émotionnel, une métaphore vivante de la domestication du capital humain.
Le coach, ce héros à PowerPoint
Le coach en entreprise est le prolongement de la volonté managériale, une extension du désir de contrôle sur l’environnement humain. Pierre Bourdieu nous rappellerait que les professions participent à des systèmes de distinction symbolique, qu’elles sont des marqueurs d’une hiérarchie sociale invisible. Faire appel à un coach, c’est affirmer un rapport à la performance, à l’excellence, à la maîtrise du désordre organisationnel. Ainsi, la présence du coach se définit moins par son efficacité mesurable que par sa charge symbolique : il s’agit moins d’améliorer les pratiques que de réaffirmer une ambition de pouvoir.
Séance tendue, post-it détendu
L’interaction qui se déploie lors d’une séance de coaching relève d’un rituel quasi-religieux. La tension de l’attente, la mise en scène d’un espace neutre, le langage codifié, puis la révélation finale mènent à une catharsis moderne qui rappelle les rites initiatiques, même dans leur version la plus édulcorée par le management.
Claude Lévi-Strauss, dans son Anthropologie structurale, a montré comment certaines pratiques sociales reproduisent des structures profondes inscrites dans la culture. Le coaching participe de cette survivance : il rejoue l’antagonisme primordial entre l’individu et le collectif. Sa pratique implique une mise en scène qui va bien au-delà du simple fait d’améliorer des compétences ; elle actualise la relation entre l’aspiration personnelle et la norme sociale, entre l’authenticité et la conformité.
L’art et la manière de dire « synergie »
Le coach en entreprise, au sens de Jean Baudrillard dans La société de consommation, est le personnage hypermoderne par excellence : réduit à un corpus de méthodes et à une présence bienveillante, il incarne une efficacité pure, une ingénierie de la transformation, portée à son paroxysme dans sa version « disruptive ». Son apparence est d’une neutralité calculée, d’une empathie millimétrée. Il n’est pas anodin que la figure n’ait guère évolué depuis son émergence : sa forme est si adaptée à sa fonction qu’elle est devenue archétypale, à l’image de ces personnages intemporels que Baudrillard qualifierait de « simulacres contemporains ».
Je trouve sabir que tout
Dans la liturgie managériale contemporaine, le coach se distingue par sa maîtrise d’un idiome particulier, véritable lingua franca des organisations. Derrida aurait sans doute vu dans ce « globish managérial » une déconstruction involontaire du langage, où les mots sont vidés de leur substance pour mieux circuler dans l’économie symbolique du travail.
« Team building », « mindset », « empowerment », « leadership », « soft skills », « drivers » : cette terminologie constitue un système sémiotique autonome que Roland Barthes aurait qualifié de « mythologie moderne ». Le coach, tel un chamane moderne, manipule ces signifiants flottants pour créer l’illusion d’une transformation profonde. La beauté paradoxale de ce vocabulaire réside dans sa capacité à évoquer simultanément tout et rien, à créer un espace de projection où chacun peut interpréter selon ses propres attentes.
Noam Chomsky verrait probablement dans cette novlangue corporate une structure profonde révélatrice des mécanismes de pouvoir : évacuer l’ambiguïté inhérente à l’expérience humaine pour la remplacer par un système binaire d’optimisation où tout devient « challengeant » mais jamais impossible, « complexe » mais toujours « actionnable ». L’art suprême du coach consiste précisément à faire résonner ces mantras désincarnés jusqu’à ce qu’ils produisent une forme d’adhésion, comme si la répétition du mot « agilité » pouvait, par effet performatif, transformer une organisation sclérosée.
Le coach en entreprise, au sens de Jean Baudrillard dans La société de consommation, est le personnage hypermoderne par excellence : réduit à un corpus de méthodes et à une présence bienveillante, il incarne une efficacité pure, une ingénierie de la transformation, portée à son paroxysme dans sa version « disruptive ». Son apparence est d’une neutralité calculée, d’une empathie millimétrée. Il n’est pas anodin que la figure n’ait guère évolué depuis son émergence : sa forme est si adaptée à sa fonction qu’elle est devenue archétypale, à l’image de ces personnages intemporels que Baudrillard qualifierait de « simulacres contemporains ».
« Le coach en entreprise, mythe contemporain d’une société en quête perpétuelle de croissance personnelle comme ultime refuge face à l’incertitude structurelle »
Fin de moi difficile
Le coach en entreprise incarne aussi le besoin de l’individu contemporain de structurer son identité professionnelle. Jacques Lacan, dans ses travaux sur le stade du miroir, évoque le besoin de reconnaissance pour constituer le moi. Le coach, par sa capacité à refléter une image idéalisée du sujet, représente une stabilisation de l’identité vacillante. Son intervention symbolise la victoire du principe de performance sur l’angoisse d’inadéquation. La satisfaction tirée de la relation de coaching révèle un processus plus profond : la confirmation d’un potentiel contre l’impuissance redoutée, aussi illusoire soit-elle. Quand le coach vous assure que vous êtes « en capacité de », c’est votre moi professionnel qui, dans un dernier sursaut existentiel, tente de se convaincre qu’il n’est pas encore totalement dilué dans l’océan de l’indifférenciation corporate.
Le café est froid, la métaphore est chaude
En somme, le coach en entreprise, à première vue praticien utilitaire, condense en profondeur de multiples valeurs : un instrument de pouvoir et de classification sociale (Bourdieu), une réminiscence des rituels archaïques d’initiation (Lévi-Strauss), un modèle d’efficacité fonctionnelle et relationnelle (Baudrillard), et un moyen de réduction de l’angoisse existentielle (Lacan).
Personnage discret mais influent, le coach en entreprise rappelle que les pratiques professionnelles les plus anodines trahissent des structures profondes qui organisent notre rapport au travail. Dans sa bienveillance instrumentalisée, il est un mythe contemporain : celui d’une humanité professionnelle en quête perpétuelle de sens face à la déshumanisation qu’elle pressent dans ses propres créations organisationnelles.
(c) Ill. têtière : Alice Bailly, Tireurs d’arc, 1911. Musée des beaux-arts de Lausanne

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.












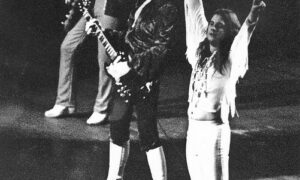































Commentez cet article de Pr4vd4