Le fait divers, selon Roland Barthes, se définit par une structure narrative singulière, qui en fait un objet médiatique à la fois répétitif, moralisateur et spectaculaire. L’affaire Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien accusé de viols et d’agressions sexuelles sur 299 mineurs présumés entre 1990 et 2014, s’inscrit pleinement dans cette mécanique du fait divers, tout en la dépassant par son ampleur et sa portée symbolique. Ce cas interroge non seulement le rapport de notre société à la violence sexuelle et aux figures d’autorité, mais aussi la manière dont le fait divers fonctionne comme un récit structurant, produisant ses propres mythologies et simulacres.
La structure du fait divers : du récit au mythe
Dans Structure du fait divers, Barthes souligne que ce type de récit obéit à une logique de clôture : il se présente comme une histoire autonome, isolée du contexte social plus large. L’affaire Le Scouarnec illustre parfaitement cette dynamique : bien que s’inscrivant dans un continuum d’abus institutionnels (comme en témoignent les scandales récents dans l’Église ou le sport), elle est traitée comme un cas singulier, un monstre isolé, plutôt qu’un symptôme d’un système plus vaste.
Le fait divers s’apparente ainsi au mythe, au sens barthésien du terme : il dépolitise, transforme une réalité sociale en un récit figé, qui fascine et terrifie tout en évacuant les conditions systémiques qui l’ont rendu possible. Ici, la figure du chirurgien-pédocriminel devient une incarnation du mal absolu, à la manière des figures monstrueuses du folklore : un docteur, soignant des enfants, qui incarne en réalité leur plus grande menace. Cette inversion du rôle social alimente une narration binaire, où le coupable absolu s’oppose aux victimes innocentes, écartant toute réflexion sur les failles institutionnelles qui ont permis ces abus.
Le simulacre du fait divers : entre réalité et fiction
Dans Simulacre et simulation, Jean Baudrillard évoque l’effacement progressif de la frontière entre réel et sa représentation médiatique. L’affaire Le Scouarnec, en tant que fait divers hypermédiatisé, devient un simulacre : un événement dont la couverture médiatique finit par se substituer à la réalité. L’image du chirurgien pédocriminel est construite selon des codes narratifs précis, qui rappellent les archétypes du thriller : une double vie, un carnet secret contenant les détails de ses crimes, un long silence institutionnel. Ce n’est pas un hasard si ces éléments, révélés progressivement, renforcent l’effet de suspense et d’horreur, transformant l’affaire judiciaire en une sorte de récit à rebondissements destiné à captiver l’opinion publique.
Or, cette logique du simulacre tend à réduire la portée sociologique du crime : plus l’histoire semble exceptionnelle, plus elle se détache du réel et empêche toute réflexion structurelle. La médiatisation crée une illusion de compréhension (« tout est expliqué, il est le monstre, le mal est identifié ») alors que les causes profondes restent intactes.
Les symboles du fait divers et leur impact social
L’affaire Le Scouarnec mobilise plusieurs symboles puissants, qui renforcent son ancrage dans l’imaginaire collectif :
- Le chirurgien, figure d’autorité trahie : le médecin est traditionnellement associé au soin, au savoir et à la confiance. Cette affaire inverse cette image en transformant l’homme de science en prédateur, jouant sur l’angoisse fondamentale de la confiance abusée.
- Le carnet secret, mémoire du crime, incarne une mémoire incriminante et fascine autant qu’il répugne. Il fonctionne comme un « journal intime du mal », une archive qui alimente la narration criminelle en renforçant l’image d’un calcul froid et méthodique.
- Les victimes invisibles initialement anonymes, puis révélées, sortent progressivement de l’ombre, en écho aux mouvements de libération de la parole comme #MeToo. Elles incarnent l’antithèse du criminel, la figure du survivant qui reconstruit sa voix après l’oppression du silence.
Loin d’être un simple fait divers anodin, l’affaire Le Scouarnec révèle la manière dont notre société fabrique des récits autour de la transgression et de la justice. En nous fascinant autant qu’en nous horrifiant, elle nous confronte à la mécanique du fait divers lui-même : un récit qui oscille entre explication et mystification, entre dénonciation et reconstruction mythologique.
A lire : Exposition – Le fait divers au MAC VAL
***
(c) Ill. têtière : photo de suntorn somtong

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter => Se connecter ou s inscrire sur Pr4vd4
Leave a Reply
Leave a Reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.














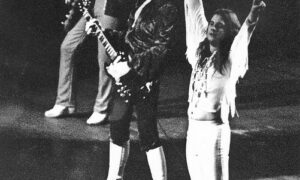





























Commentez cet article de Pr4vd4